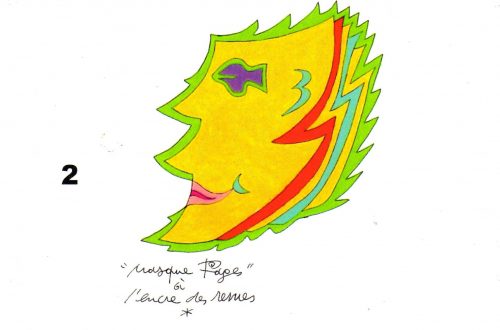Jean-Pierre Chambon : Anthropogénie, Epiphanie et mémoire poétique.
Par Fidèle Mabanza
Jean-Pierre Chambon vit à Grenoble. Poète et auteur de récits, il co-dirige la revue Voix d’encre, collabore régulièrement avec des artistes – peintres, poètes, photographes. En 2021, lors d’une rencontre à La Cave Littéraire de Villefontaine, j’ai découvert sa complicité avec Michaël Glück dans un dialogue fécond, notamment dans Méditation sur un squelette d’ange ((Éditions L’Amourier, 2004) et Une motte de terre (Éditions Méridianes, 2020).
Traduit dans une dizaine de langues, il a reçu le prix Roger-Kowalski 2025 pour Étant donné (Éditions Al Manar, 2024) et le prix international de poésie francophone Yvan-Goll en 1996 pour Le Roi errant (Éditions Gallimard, 1995).
Cette note lie son œuvre selon deux axes : l’anthropogénie, soit l’émergence de l’humain à partir de la matière ; et l’épiphanie poétique, où vie et sacré se révèlent dans l’épaisseur du sensible. Sa poésie, réceptive au mythe de la création, se fait lieu d’expérience du vivant.
Ces orientations s’inscrivent dans une métaphysique cosmologique où Une motte de terre figure l’origine et le destin. Terre des labours et des sépultures, elle renvoie au sépulcre qui conforme l’homme au radicalement autre. C’est dans ce champ de forces que s’inscrit la lecture ici proposée.
I. Anthropogénie : l’homme né de la matière
Jean-Pierre Chambon pense l’humain dans son rapport originaire à la matière. Il explore son devenir au sein du vivant, comme si la parole, au-delà des vérités du mythe des origines, naissait du minéral, du végétal et de l’animal avant d’accéder au langage. C’est une véritable anthropogénie poétique où l’humain se fonde dans l’expérience sensible du monde.
Son geste prolonge celui de Michaël Glück, à l’origine du poème Une motte de terre, un livre, insolite par sa forme, qui les met en dialogue autour d’un acte premier : Ramasser simplement une motte de terre (Francis Ponge).
Jean-Pierre Chambon évoque la parenté de l’homme, né de la poussière, avec la matière habitée du sacré. Le SEIGNEUR Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol (TOB, Gn 2, 7), – la terre arable et les êtres vivants. Sa langue est une matrice verbale, faisant résonner les strates symboliques et étymologiques :
- Hébraïque : hā’ādām « terrien », renvoie à ’adamah, la terre ;
- Latine : humus « sol » ; qui dit à la fois l’humilité et le retour à la terre ;
- Grecque : gê « terre cosmique » et khthôn « terre chthonienne, matricielle et funéraire).
Ce réseau étymologique éclaire la profondeur de ses vers :
tout l’humain / dont le nom même / se souvient de l’humus / paraît encore imprégné / de l’obscure pensée de la matière / comme s’il avait germé / au sein de la terre-mère (Jean-Pierre Chambon, Une motte de terre, p. 4).
Trois motifs structurent cette anthropogénie :
- La création à partir de la terre :
d’une motte de terre / d’une poignée d’argile / fut façonné Adam / de la même boulette / de pâte à modeler / fut dissociée Eve (Ibid., p. 7)
Le poème sous-tend l’unité indivisible et l’égalité fondamentale de l’humanité.
- La dimension charnelle et chthonienne :
la terre est une chair / inerte et insensible / la matière première / du chaos originel / dont on tire les formes / que l’esprit échafaude (Ibid., p.7)
La matière est à la fois substrat inerte et vectrice de potentiel créatif.
- La mémoire enfouie :
de la matière spongieuse / de la tourbe remonte / la cavalcade d’autres images / d’une mémoire enfouie / depuis des temps inconnaissables (Ibid., p. 9)
L’origine humaine se relie à une mémoire à la fois cosmique et mythique. L’homme, enfant de la terre, porte en lui une mémoire tellurique qui le dépasse. Du microcosme de la motte de terre au macrocosme des galaxies, il est façonné par la matière et ouvert au symbolique.
En miroir, Michaël Glück, fidèle à l’esprit de Ponge, donne un écho laïc à la formule biblique et affirme la vénération de la matière :
Or, la vénération de la matière :
quoi de plus digne de l’esprit ? (Francis Ponge, cité in Michaël Glück, Une motte de terre, p.7)
Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. (TOB, Gn 3, 19).
Ainsi se révèle la double vocation de la terre: berceau et tombeau.
Entre les strates mythiques et cosmogoniques de Chambon et la matérialité tactile de Glück, la matière devient le fondement de l’humain :
la terre est une chair dont on tire les formes, et l’esprit en façonne le sens (cf. Jean-Pierre Chambon, Une motte de terre, p. 7).
II. Épiphanie poétique : révéler le vivant dans l’infiniment petit
Jean-Pierre Chambon célèbre l’infime non comme geste héroïque, mais comme élan vital presque sacré. De la petite giroflée mauve (Étant donné, p. 9), du rhizome de mandragore à un sanglier (Une motte de terre, p. 4), terre, animal et humain s’entrelacent. L’écriture devient matricielle : le tronc du mot arbre (Ibid., p. 2) se fait abri, tandis qu’un insecte xylographe y grave son propre poème sibyllin. Le mot latin liber, désignant à la fois le livre et la sève, consacre cette fusion du langage et du vivant. Ainsi le monde devient livre vivant, porteur d’une écriture plus ancienne que les mots.
L’auteur saisit subtilement un instant anodin et en révèle l’intensité poétique. Dans Même pas peur (Étant donné, p. 10), une scène enfantine devient lieu d’inversion symbolique, où la peur de l’enfant se renverse en liberté joyeuse :
J’adore / les morts-vivants / m’a répondu / tout à trac / en me dévisageant / de ses grands yeux / étincelants / la petite fille / à qui j’avais / bêtement demandé / si elle n’avait / pas peur / des monstres
Le poème L’avenir (Ibid., p. 11) relie présent et mémoire adolescente :
Il y a bien longtemps déjà / que j’ai rejoint ce futur nébuleux / dans lequel adolescent je voyais / depuis mon lit s’enfoncer l’angle formé / par les murs et le plafond de ma chambre
Un détail apparemment banal devient faille temporelle : la conscience adolescente scrute un avenir indéfini. L’écriture suit le rythme d’une méditation nocturne, ponctuée d’intimité et de rêverie.
Dans Transsubstantiation (Étant donné, p. 40) :
la lumière filtrée par un vitrail… transfigure la fragilité en présence, suggérant que le sacré se donne dans l’instant. Ce mouvement fait écho au khthôn de Une motte de terre, où vie, mort et langage s’entrelacent dans un flux continu, dans une tonalité rêveuse rappelant Jaccottet ou Bonnefoy.
Dans Le lourd verrou (Étant donné), une démolition urbaine ravive un trauma intime : la ville se reconstruit, mais le bulldozer éventrant la boutique et la maison voisine résonne comme le claquement d’un lourd verrou refermant un pan d’ombre sur la vie du sujet. (cf. p. 13)
Le réel urbain et la mémoire personnelle s’interpénètrent dans un geste de deuil silencieux.
Dans un geste simple, Les Veilleurs (Étant donné, p. 15), devient un rituel éthique :
comme pour adresser en pensée / son salut fraternel / à la communauté secrète des veilleurs
Le geste simple d’adresser en pensée son salut fraternel à la « communauté secrète des veilleurs » devient un rituel éthique. Cette communauté paradoxale, faite de solitudes et de fenêtres séparées, révèle l’altérité radicale de l’autre : l’observateur le reconnaît dans sa différence irréductible, établissant un lien de responsabilité et de fraternité silencieuse, au-delà de tout savoir commun.
Œuf d’or (Étant donné, p. 64) : le regard bascule du quotidien vers l’intensité sacrée. L’œuf de Pâques oublié brille soudain entre les hortensias, transformant le réel ordinaire en moment d’épiphanie. La poésie naît de l’attention portée à ce qui est là, révélant la vulnérabilité de la présence et la profondeur du monde le plus simple.
III. Mise en regard : continuité et héritage
Jean-Pierre Chambon dialogue avec ses devanciers tout en affirmant sa singularité. Il prolonge une lignée poétique, notamment avec Philippe Jaccottet, partageant une attention au fragile et aux choses discrètes. Sa poésie s’articule à l’intersection de la phénoménologie et d’une anthropogénie poétique, mettant en jeu un continuum entre matière, conscience et espace. Dans Le Nil (La remontée des eaux, 2025, pp. 35-36) comme dans La rivière Singapour (ibid., pp. 43-44), l’écriture passe de la notation sensorielle minutieuse – trafic, reflets, architectures – à une perception décalée du réel : dédoublement hallucinatoire, décor artificiel. Concret et métaphysique s’articulent dans un même mouvement.
La cohue humaine et automobile suscite une expérience d’hyper-perception où le corps est confronté à l’excès du sensible. La promenade sur le fleuve, loin d’être un simple répit, ouvre à une verticalité où la conscience se trouve aspirée vers un vertige cosmique accueilli dans le silence. Dans La rivière Singapour, l’artificialité du visible, à travers des signes lumineux quotidiens, transforme le détail prosaïque en seuils d’expérience élargie. Sémaphores (Étant donné, p. 50) confirme que la poésie de Chambon fait émerger un sacré immanent à même la matérialité scintillante du réel.
Cette dynamique se retrouve dans Une motte de terre (p. 3), qui convoque la mémoire de l’aïeul laboureur. Le geste agricole devient métaphore du geste scriptural : sur ses pas dans les sillons / on a éparpillé la semence / de mots égrenés lettre à lettre. L’humus se fait matrice et métaphore ombilicale du langage, la terre ventre gravide. L’écriture prend racine dans une filiation archaïque où travail de la terre et travail du poème s’unissent.
L’œuvre de Chambon inscrit la poésie dans une continuité entre sensoriel et spirituel, simulacre et épiphanie, mémoire et héritage. Elle propose une anthropogénie poétique où l’humain se constitue à travers double arrachement et enracinement, dans la matière du monde et la mémoire des gestes fondateurs.
En conclusion, Jean-Pierre Chambon déploie une véritable géopoétique : un mouvement du mot à la matière, du mythe au cosmos, du jeu enfantin au tragique de la mort. Une motte de terre s’oriente vers la dimension cosmologique et mythique, Étant donné vers une approche quotidienne et phénoménologique. Dans cette tension complémentaire, sa poésie, multiple et ouverte, invite le lecteur à une saisie élargie du réel.
Livres de l’auteur analysés :
- Une motte de terre,Éditions Méridianes, 2020, 24 p.
- Étant donné, Al Manar, 2024, 119 p.
- La remontée des eaux, L’Étoile des limites, 2025, 96 p.
Fidèle Mabanza